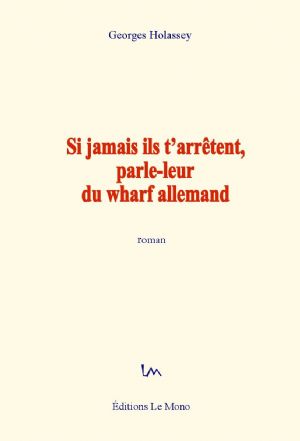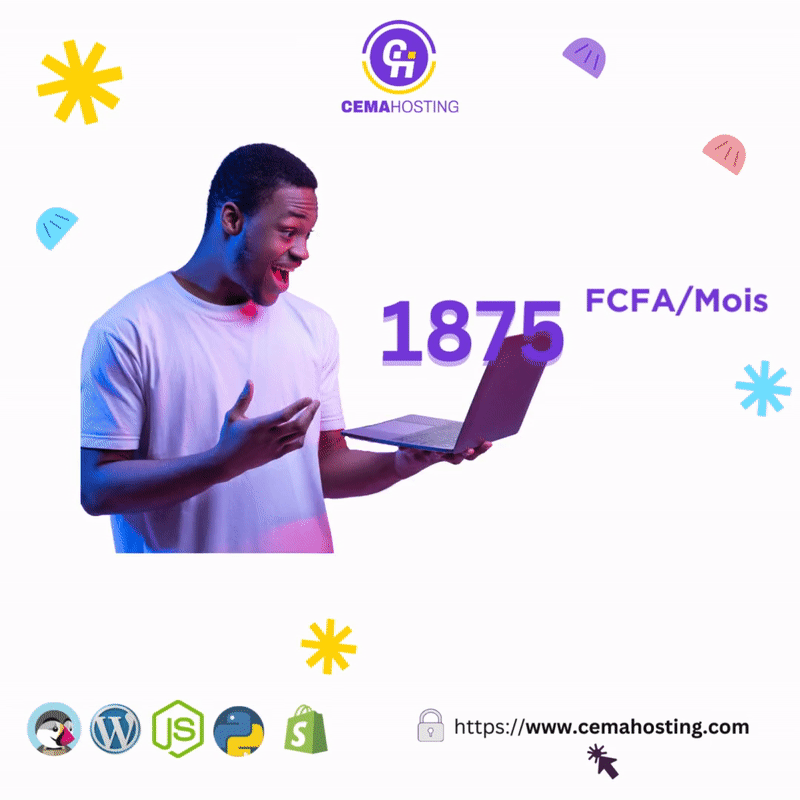EXTRAITS
J’ai décidé de quitter la région parisienne pour Baden-Baden parce que je ne me sens plus en sécurité.
Tout me plonge dans une angoisse terrible. Un regard croisé dans la rue, et j’ai peur qu’on m’ait identifié pour me dénoncer à la préfecture. Quelques sons de sirène entendus au loin, et je frémis pendant des heures, perché à la fenêtre : est-ce la police qui vient me chercher ?
Ma vie est devenue infernale. J’ai pensé qu’il me serait plus agréable de vivre en Allemagne, que je retrouverais une vie plus sereine à Baden-Baden. D’ailleurs, peu m’importe le lieu où je vivrai, pourvu qu’on m’y laisse tranquille.
J’ai pris le train cet après-midi après une longue réflexion sur cette destination hors de France. Baden-Baden. Une ville dont je n’ai pas entendu vanter une quelconque hospitalité envers ceux de ma catégorie, mais qui m’attire pour avoir offert une vie à mon cousin. Et je suis parti.
Le train est bondé de supporters du Paris-Saint-Germain qui joue ce soir contre le Racing Club de Strasbourg. Un match important, paraît-il. Et ils crient sans cesse «les Strasbourgeois vont prendre une raclée ce soir!». Buvant et fumant dans le train comme pour provoquer les contrôleurs ou exaspérer les voyageurs. Il n'y a que très peu de répit. Quelques secondes où ces tapageurs survoltés semblent faire une pause pour reprendre leur souffle ou boire un coup. Et au moment où on pense avoir un peu de calme, au moment où ces dames allemandes assises en face de moi croient pouvoir lire leur revue tranquillement, il y en a toujours un qui crie «les Strasbourgeois vont prendre une raclée ce soir!» et emporte les autres dans un raffut insupportable. Je prie pour qu’il n’y ait pas de bagarre. Être présent sur le lieu d'une rixe, c’est ce qu’il y a de plus funeste pour quelqu’un de ma catégorie. On risque d’être contrôlé par la police et arrêté.
Cette peur d’être contrôlé me fait soudain penser à la frontière. Même si l’Europe est devenue un seul pays comme on le dit, avec des frontières muettes qui ne demandent plus de pièces d’identité aux voyageurs, il suffit par malheur qu’un vieux démon des nations se réveille au moment où le train arrive à la frontière allemande. Et une frayeur irrépressible me traverse le corps. J’ignore l’allemand et ne peux pas leur expliquer ma situation si jamais ils m’arrêtent. Les quelques expressions que Klaus nous avait apprises, je les ai oubliées. C’est un vieil Allemand qui vivait chez nous, dans une maison non loin de l’océan, un pavillon à la façade décrépie à cause du vent chargé de sel. Klaus ne travaillait pas et je ne saurais dire de quoi il vivait. On racontait que des amis ou des proches parents lui envoyaient un peu d’argent depuis l’Allemagne. Allez savoir combien ils lui envoyaient pour lui permettre de vivre sans travailler. Pas beaucoup je crois, car il ne vivait pas comme un riche et semblait souffrir de faim. Il souffrait aussi du paludisme et avait parfois des douleurs d’estomac à cause des amibes et des ascaris, ces vers qui pullulaient dans l’eau, à l’affût dans les aliments pour nous parasiter l’estomac.
Klaus regrettait que notre pays ne soit pas resté sous domination allemande. Nous serions nés germanophones au lieu d’être nés francophones. Et cela lui aurait facilité la communication avec nous. Nous avions du mal à retenir les expressions qu’il nous apprenait, parce que c’est quand même difficile l’allemand. Et puis, nous ne voyions pas l’intérêt d’apprendre une langue qui n’est plus parlée chez nous depuis la fin de la Grande Guerre. Depuis ces jours où les Allemands avaient été obligés de plier bagage après les dernières explosions ayant donné la victoire aux alliés et renvoyé leurs colonies à Berlin ou à Munich.
Si quelqu’un pouvait dire à Klaus où je me trouve aujourd’hui, s’il pouvait savoir comment je vis depuis que je suis arrivé en France, il dirait, comme il le disait souvent, « vous avez un très beau pays, mon petit; pourquoi partir ? » Et il ne comprendrait vraiment pas pourquoi je suis parti.
…
Je n’arrive pas à trouver le sommeil. Je suis content et à la fois inquiet. Je suis content d’avoir trouvé un toit. Je ne pense pas que Gaétan me mettra à la porte demain ou après demain. Mais je suis inquiet des jours à venir. Jusqu’à quand durera cette vie d’errance? Cela fait déjà trois ans que je suis en France, mais j’ai l’impression que je suis en train de tout recommencer à zéro. Je me tourne d’un côté, puis de l’autre, cherchant à dissiper cette inquiétude qui m’ôte le sommeil. J’ai fait le choix de tenter l’aventure, ce n’est pas le moment de baisser les bras. Sinon, c’est la mort.
En Europe, peu de personnes comprennent pourquoi des gens comme Flavien et moi ne retournent pas chez eux, alors qu’ils en ont marre de cette vie d’errance. Certains ne cherchent même pas à comprendre. Mais il faut quand même leur dire qu’il n’y a pas d’effet sans cause. La cause de ces aventures souvent difficiles et parfois périlleuses, c’est cette énorme différence qui existe entre la vie d’ici et celle de là-bas. Prenons seulement le cas de la monnaie. Imaginez seulement qu’un euro fait plus de six cent cinquante francs CFA, et qu’avec cinquante euros envoyés aux parents, ils peuvent manger pendant plusieurs semaines. Comment voulez-vous que ceux qui sont là-bas n’aient pas envie de venir tenter leur chance ici pour aider leurs parents qu’ils voient démolir par la misère?
La rivière coule toujours vers l’aval, disait mon père. C’est une loi de la nature. Partir vers là où l’odeur de la vie semble plus agréable, c’est aussi une réaction naturelle, je crois.
D’où je viens, il y a des vies plus malheureuses que la mienne. Des vies qui s’accrochent à l’espoir de trouver l’opportunité pour partir vers le nord et pouvoir aider les parents qui n’en peuvent plus de souffrir; vieillissant plus vite que le temps parce qu’ils sont privés de tout. De nombreux jeunes cherchent l’occasion à saisir pour partir et pouvoir les rendre heureux.
Beaucoup sont partis comme ça, juste avec quelques affaires ou avec rien du tout. Lorsque l’occasion s’est présentée, ils sont partis comme on fuit un danger, sans aucune préparation. Ils se sont jetés dans l’aventure avec pour seul bagage l’espoir. C’était le cas de Philippe dont on avait longtemps parlé chez nous. Et on en parle sûrement encore. Non seulement c’était un phénomène ce gars, mais l’histoire de son voyage était et demeure l’une des plus surprenantes. Sûrement parce qu’il était le premier dans le quartier à se lancer dans une telle aventure. Personne avant lui n’avait osé partir comme ça, sans avoir préparé le voyage, sans être sûr qu’à l’arrivée il y aurait quelqu’un pour l’accueillir. L’aventure faisait vraiment peur. C’était comme ça chez nous, je vous assure.
Philippe était vraiment un phénomène. Un de ces hommes qui font des choses qui vous étonnent ou vous énervent, mais qui les font quand même, comme pour se moquer du monde. Philippe était comme ça ; il énervait tout le monde. Il passait tous les jours avec sa mobylette, une Motobécane surannée de son père qu’il avait remise sur les roues, mais qui avait du mal à se remettre de son état de vieille machine abandonnée à la fourrière pendant de nombreuses années. Il l’avait récupérée avec douze mille francs CFA, une sacrée somme que son père n’avait pas pu rassembler avant de partir s’installer au village, fatigué de la vie dans la capitale. Le gars Philippe passait et repassait plusieurs fois par jour sur ce vieil engin crachant d’épaisses fumées qui empestaient les rues après son passage. Il nous lançait en passant : «Holé les amis, la vie est belle?» C’est comme ça qu’il criait chaque fois qu’il croisait ou dépassait ceux qu’il connaissait. Il connaissait d’ailleurs tout le monde. Et il ne réagissait pas quand on criait derrière lui : «va te faire voir ailleurs avec cette pourriture de mobylette, espèce de … !» Il s’en fichait ; ou ne les entendait même pas, ces insultes couvertes par les vrombissements assourdissants de cette vieille Motobécane ressuscitée qui peinait à tenir le coup.
Il était sans emploi et se débrouillait comme la plupart des jeunes. Il allait tous les jours au port pour tenter de trouver un job ou de petites bricoles à faire pour gagner de quoi payer à manger et l’essence pour cette antiquité qui roulait à trente à l’heure et fumait comme un train à vapeur.
Puis, on ne le voyait plus. Le bruit courait que le gars Philippe aurait trouvé un emploi dans un bateau. Il serait parti en mer pour six mois et reviendrait avec toute l’économie de son salaire, puisqu’il n’y a aucune dépense à faire sur un bateau. Ils sont nourris, logés ; il suffit de trouver un endroit sûr pour planquer son argent.
Comment avait-il fait pour dénicher ce job de luxe? Nous étions tous intrigués par son histoire.
Le gars Philippe n’est jamais revenu. On racontait qu’il aurait réussi à entrer en Espagne pour y travailler. Lui qui ne connaissait personne dans ce pays, aurait trouvé du travail dans les champs pour la cueillette des tomates. Et son salaire mensuel pourrait nourrir beaucoup de personnes au pays pendant trois mois.
C’est ainsi que travailler sur un bateau était devenu le rêve des jeunes qui hantaient le port. Ils étaient excités quand les bateaux accostaient. Et lorsqu’ils s’en allaient à travers les flots, ils les regardaient partir les yeux embués de larme, tristes de ne pas avoir trouvé l’occasion de monter à bord.
Beaucoup sont partis après le gars Philippe. Ils sont partis par différents moyens, pour aller chercher quelque chose de mieux que ce que nous avons là-bas. Qu’avons-nous d’ailleurs là-bas? Pas autre chose que l’attente et le rêve. La résignation aussi parfois. La démocratie tant attendue, imposée par le sommet de la Baule et lancée par des conférences nationales un peu partout, n’arrive pas à nous améliorer la vie. On vit toujours dans l’attente de jours meilleurs; une attente interminable qui fait ralentir la vie pour les plus jeunes et précipiter les plus âgés vers la fin. Il faut le vivre pour comprendre ce que disait le poète Rilke : l’attente c’est la vie au ralenti, c’est le coeur à rebours, c’est une espérance et demie ; … c’est le train qui s’arrête en plein chemin, sans nulle station … et on entend le grillon ; on contemple en vain.
Lorsque l’attente devient insupportable, lorsque vous ne trouvez aucun moyen de vous en sortir que de franchir le mur de l’aventure, vous n’avez pas d’autres choix que de l’enfoncer.
C’est l’espoir de partir ailleurs qui fait tenir le coup, parce qu’on n’attend plus rien de la nature et des responsables politiques. Et la résignation l’emporte parfois, lorsque, après avoir fait tous les efforts, on n’arrive pas à percevoir le bout du tunnel.
…
Chez nous, le seul qui n’encourageait personne à partir et qui disait que ces voyages ne sont pas une solution et qu’il faut se battre pour s’en sortir et non fuir vers ces pays du nord où rien n’est sûr, le seul qui disait ces choses qui rentraient d’une oreille et sortaient de l’autre, c’était Klaus, le vieil Allemand. Celui qui m'avait appris quelques expressions en allemand ; qui vivait non loin de l’océan, dans une maison à la façade décrépie. Cet Allemand qui allait lui-même chercher de l’eau à la fontaine publique parce qu’il n’avait pas les moyens d’engager une bonne comme tous les blancs de chez nous. Il se débrouillait avec son corps fatigué et vivait comme un des nôtres, comme un vieil homme qui n’avait pas de famille.
Il nous arrivait de lui demander pourquoi il ne rentrait pas chez lui en Allemagne. Et il répondait toujours qu’il avait choisi de vivre chez nous parce qu’il n’aimait pas la vie en Europe ; une vie trop matérialiste, trop stressante, loin de sa philosophie. Trop matérialiste et trop stressante? Que voulait-il dire exactement? On ne comprenait pas vraiment. Ce qu’il appelait sa philosophie, c’était de vivre simplement avec la nature. Il n’aimait pas cette vie européenne qui lui faisait péter les plombs, disait-il. Et il faisait l’éloge de la vie calme et tranquille de chez nous, de cette nature agréable dont il aimait respirer avec délices l’odeur apaisante du matin, loin de la pollution, du stress et de l’esprit capitaliste. Loin de ces gens qui n’ont plus le temps pour une vie simple et qui ne savent plus apprécier les petites merveilles de la nature. Il disait que ce n’est pas très agréable la vie en Allemagne parce qu’on court tout le temps. C'est donc à la recherche d'une vie simple et tranquille qu'il est venu vivre à Lomé, dans ce dénuement qui nous faisait de la peine pour lui qui a pourtant la chance d’être né dans un pays riche. Mais il aimait cette vie, il était heureux malgré tout. Et quelques filles du quartier allaient de temps en temps lui porter ses courses et lui préparer des plats de chez nous, avec moins de piments bien sûr, parce qu’il leur disait : « pas trop de piments, pas trop de piments dans la sauce, je ne suis pas habitué.» Et le jour où elles avaient la main lourde et qu’elles en mettaient un peu plus que d’habitude, on le voyait la bouche ouverte pendant des heures.
Klaus n’était pas de grande taille, contrairement à ce que disait mon grand-père des Allemands. Il disait, mon grand-père, que tous les allemands étaient de grande taille. Et il aimait les appeler «Allemands plus solides que le fer», non seulement pour leur physique mais surtout pour leurs constructions d’une solidité impressionnante. Et il nous parlait de leurs réalisations depuis le début de la colonisation, depuis ces années 1880 où ils débarquèrent chez nous avec leur chef Nachtigal. Ils étaient là pour «civiliser nos aïeux» et leur montrer comment construire des bâtiments en blocs de pierre et des routes en asphalte. Ces routes qui leur facilitaient surtout le transport des matières premières vers la côte pour les envoyer loin, par l’océan, vers l’Europe. Ils avaient aussi construit le wharf dont on voit toujours des vestiges à Lomé. Le wharf, c’est le moyen qu’ils avaient trouvé pour charger et décharger les bateaux avant la construction du port. Ils savaient tout faire, les Allemands, disait mon grand-père. Il les aimait bien ces « Allemands plus solides que le fer ».
Des routes et des bâtiments, ils en avaient vraiment construits, de très solides, qui résistent encore à toute sorte d’intempéries. Et lorsqu’il devient nécessaire de détruire ces vieilles routes allemandes pour en construire de nouvelles plus larges, il faut plus que quelques coups de marteaux-piqueurs. Il faut des bulldozers et mobiliser des moyens assez importants pour casser l’asphalte et arracher le béton de la terre. C’est comme ça qu’ils sont les Allemands dans toutes leurs constructions, «plus solides que le fer».
Et Klaus qui n’était pas de grande taille et n’avait jamais construit de route, lui qui voyait sa maison s’étioler sans réagir parce qu’il n’avait pas les moyens, on l’appelait aussi «Allemand plus solide que le fer» parce que c'était un Allemand malgré tout. Il avait cette démarche imposante comme celle d’un géant, portant toujours fièrement sa tête, même quand la maladie et la fatigue lui voûtaient le dos. Il marchait avec cette allure de gaillard, comme tous les «Allemands plus solides que le fer», parce que c’était un allemand malgré tout, même s’il vivait chez nous. Et on l’aimait aussi. On l’aimait c’est sûr, parce qu’il m’arrive encore de penser à lui, l’«Allemand plus solide que le fer».
…
Et sur la plage de Lomé, il faut voir comment le vieux wharf allemand séduit encore la population et les touristes curieux de voir et de photographier ces vestiges d’un autre temps, cette jetée rouillée abandonnée aux vagues incisives de l'océan qui la rongent inexorablement. En voyant ces vieilles constructions allemandes qui résistent toujours à l’usure du temps ayant eu raison des réalisations françaises d’après-guerre ; et en suivant de près la politique française en Afrique, on regrette parfois que le pays soit passé sous tutelle française. Certains sont vraiment nostalgiques de la période allemande. Ils pensent que le sort du pays serait meilleur avec les Allemands, surtout lorsqu’ils sont déçus de la politique française jugée ambivalente et hypocrite. C’est difficile de comprendre cette nostalgie quand on sait que toute colonisation est faite pour servir avant tout l’intérêt du colonisateur. Et ce fut évidemment le cas des Allemands aussi lorsqu’ils colonisaient le pays. Ils n’étaient pas de gentils protecteurs qui dorlotaient le peuple. Loin de là. La mémoire collective fait toujours ressortir les travaux forcés sous l’époque allemande, ainsi que les châtiments corporels, ces coups de fouet dont le dernier très appuyé était dédié au Kaiser sous le cri de «Ein für Kaiser !» Et l’expression est restée dans le langage populaire. Mais lorsqu’on est déçu par la politique de la France, lorsqu’on est amer contre la Françafrique, on regrette d'être passé sous tutelle française.
Les gens ont cette nostalgie des Allemands parce qu’ils ne jouent pas double jeu, dit-on. Ils sont perçus plus rigoureux et plus francs dans leurs relations avec nos gouvernements. La réalité est peut-être différente, je n’en sais rien. Mais c’est difficile de trouver des arguments pour empêcher ces hommes et ces femmes de préférer l’Allemagne à la France. Cependant, le sort du peuple aurait-il vraiment été meilleur si la première guerre mondiale n’avait pas mis fin à la colonisation allemande? Imagine-t-on un pays, un tout petit pays comme le Togo, peuplé de noirs, sous colonisation allemande au temps d’Hitler? Quel sort aurait connu nos grands-parents sous la main puissante du Führer dont on connaît la cruauté envers les races jugées inférieures? Peut-être un exode massif vers les territoires sous domination anglaise ou française, s’il leur laissait une porte de sortie. Fuir aurait été la seule solution pour survivre. Lorsqu’on se sent menacé de mort, de torture, ou de faim, quelle autre solution pourrait-on avoir que de fuir pour sauver sa peau, ou partir vers là où la vie serait meilleure. Je n’ai donc rien inventé en quittant mon pays pour chercher une autre vie. J’ai moins honte quand j’y pense du coup, même si parfois je me sens considéré moins qu’un humain dans cette situation jugée irrégulière. …
Si jamais ils t’arrêtent, parle-leur du wharf allemand, roman, 210 p., en librairie dès le 02 Octobre 2013.
Cliquez ici pour plus d'informations sur le livre et l'auteur