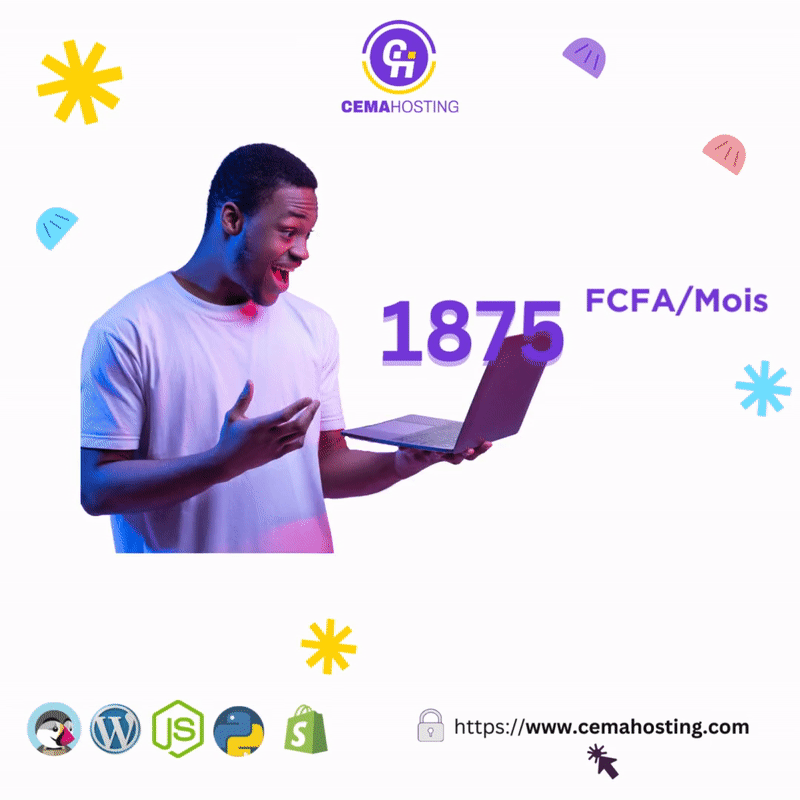Fidèle a 29 ans. Le bandeau blanc qu’il porte autour de la tête laisse entrevoir un regard fuyant. Sans doute est-il impressionné par l'attention toute particulière dont il est aujourd’hui l'objet ? Ce bout de tissu qui le distingue des autres membres de la communauté témoigne du fait qu’il est jumeau.
Des muscles courts, des membres menus, des yeux de grand timide, Fidèle ne fait guère son âge. Il semble à peine sorti de l'adolescence. Pourtant il est marié, père de famille, mais il est surtout le plus âgé des 59 jumeaux vivant dans leur communauté d'origine depuis leur naissance.
Fanivelona, un hameau de 2000 âmes, appartient au district de Nosy Varika, dans la région de Vatovavy Fitovinany. Le fait que Fidèle soit jumeau dans cette partie de Madagascar n'est pas chose banale. Si lui et ses camarades escortant les visiteurs du jour étaient nés quelques semaines avant le 5 juillet 1982, ils ne seraient peut-être plus de ce monde.
Fidèle, comme les milliers d'enfants jumeaux nés avant cette date dans les communautés Betsimisaraka Sud et Antambahoaka de Fanivelona, une localité située à 600 km au sud-est de la capitale, Antananarivo, auraient été livrés à une mort certaine, abandonnés dans un champ de café, dans une rivière ou le long du canal des Pangalanes.
Si pour la majorité des localités traversées, cette voie navigable en toute saison et qui s'étire sur près 800 km le long de la côte orientale est source de vie, pour les bébés jumeaux, le canal de Pangalanes est synonyme de destin funeste, pour ne pas dire de mort cruelle. Entassés dans des paniers traditionnels et abandonnés le long des berges de cette immense étendue d'eau, dans le froid et l'humidité, les jumeaux des ethnies Antemoro et Antambaoka connaissent, quelques heures après leur naissance, une fin monstrueuse.
Sous prétexte d'un sermon fait aux ancêtres, des milliers de parents biologiques, chez les Antambaoka et les Antemoro, sont devenus les bourreaux de leurs propres bébés-jumeaux, en les assassinant ou en les abandonnant dans la nature et, pour les plus inspirés, dans des centres d'accueil. Sans pitié, ni remords, avec la complicité de toute une communauté.
Considérées comme un signe de malédiction, les naissances gémellaires chez les ethnies Antamboaka et les Antemoro de Madagascar font l'objet d'un rejet systématique. Les rares parents qui ont le courage de braver cet interdit ou "fady" en gardant leurs jumeaux deviennent des parias aux yeux de la communauté qui ne leur laisse pas d’autre choix que l'exil, loin du village.
Cette ex-communion scelle la mort sociale des parents biologiques, puisqu'ils se verront à jamais interdits d'accès au "tranobe" la grande case, où se prennent les décisions importantes affectant les membres du clan, et privés de la protection des esprits des ancêtres sur terre et dans l'au-delà. Une double malédiction pour les Malgaches, nombreux à encore honorer les ancêtres.
Aujourd'hui Fanivelona commémore le 30ème anniversaire d'un fait historique, celui de la levée du tabou sur l'abandon des jumeaux par la population de ce hameau. Les faits remontent donc à juillet 1982, lorsqu'un médecin accoucheur, après avoir délivré une jeune maman de deux bébés jumeaux, s'est vu contraint de leur trouver des parents adoptifs. La maman avait rejeté ses bébés à leur naissance.
Devant l'impossibilité de trouver une famille d'accueil, le médecin menaça de porter l'affaire devant la justice, si au bout d'une semaine la communauté ne revenait pas sur sa décision. De menaces en négociations, un compromis fut finalement trouvé.
Il fut convenu que pour atténuer la furie des esprits des ancêtres protecteurs qui réprouvaient le maintien des jumeaux dans la communauté les "tangalamena" ou rois traditionnels devaient conjurer le mauvais sort qui allait frapper le village en sacrifiant un zébu à l'autel du village symbolisé par une grosse pierre noire au cours d'un rituel complexe au cours duquel on implorerait le pardon de ces ancêtres qui, selon la tradition malgache, facilitent le passage des morts dans « l'autre monde ».
Depuis la célébration de ce rituel du "tapake-vitra" signifiant, en langue malgache, "c'est décidé", les jumeaux sont acceptés et vivent en harmonie avec la communauté. Et le village de Fanivelona est cité en exemple pour avoir collectivement tordu le cou à ce tabou. Mais si, à Fanivelona, la raison et le bons sens ont prévalu sur la cruauté et l'ignorance, chez les autres communautés Antambaoka du sud-est, il en va autrement.
Elles continuent, à Mananjary et ailleurs, à réserver aux jumeaux le même sort que leurs ancêtres, au mépris de toutes les lois et conventions sur la protection et les droits des enfants.
Tandis qu'au rythme des tambours et du "kabosy", la guitare traditionnelle, les jumeaux de Fanivelona et leur communauté célèbrent 30 années de liberté, les "harona" ou paniers en paille destinés à la collecte des fruits ou au transport des animaux de la basse-cour et contenant des bébés-jumeaux le plus souvent dans une situation de malnutrition alarmante continuent d'affluer dans les centres pour jumeaux abandonnés.
Pour un bébé arrivant aux centres d'accueil de CATJA ou de Fantanenana, combien sont-ils encore à être enterrés subrepticement sous un caféier ou entre deux jacinthes d'eau ? Nul ne le sait avec exactitude. Long est encore le chemin à parcourir dans cette partie de la Grande île avant que la malédiction des jumeaux de Mananjary ne termine sa course folle dans la poubelle de l’Histoire.