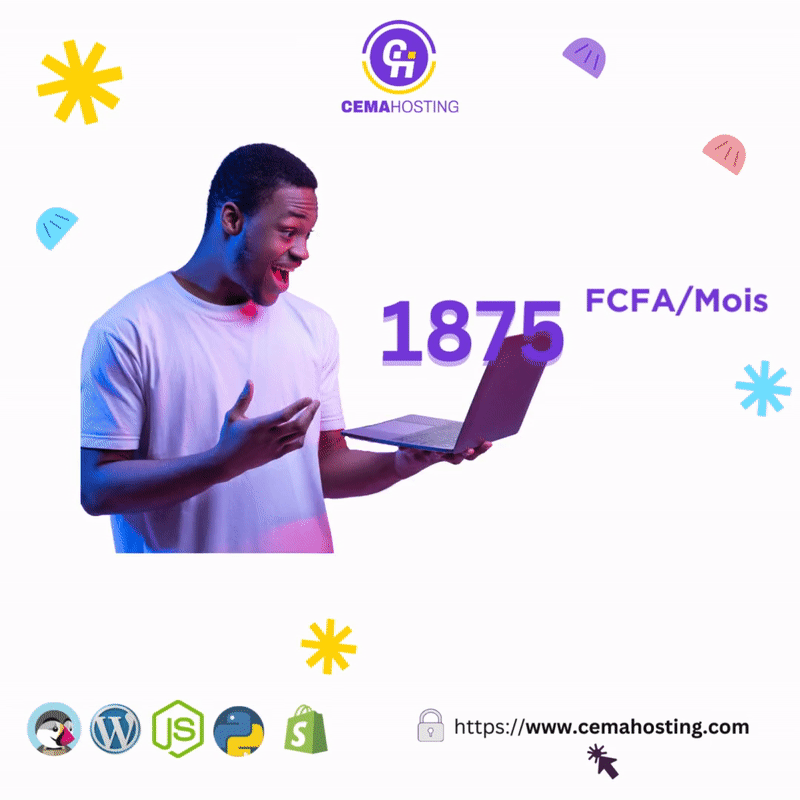Les jeunes filles sont de moins en moins nombreuses à subir des mutilations génitales féminines (MGF) de nos jours qu’il y a quelques années auparavant, sur le continent africain. Par exemple en Egypte, où le taux de MGF est le plus élevé de tout le continent, l’enquête de l’UNICEF montre que 81% des jeunes filles âgées entre 15 et 19 ans ont subi des mutilations génitales, contre 96% des femmes qui sortent aujourd’hui de la quarantaine.
Bien que cette tradition ait une place importante dans tous les pays d’Afrique, cette baisse légère peut être un présage d’un grand changement avec la nouvelle génération. Dans presque la moitié des 29 pays que comporte le continent, les jeunes filles se sentent moins à même de subir des mutilations que leurs mères ou grand-mères. Ce constat est plus fulgurant en Egypte : seul un tiers des adolescentes ayant participé à l’enquête sont favorables à ces pratiques, et deux tiers des femmes plus âgées y sont favorables.
Avec l’Egypte où 91% des jeunes femmes entre 15 et 49 ans ont subi des mutilations génitales, les pays les plus touchés d’Afrique sont la Somalie avec un pourcentage de 98%, la Guinée ,96%, Djibouti, 93%, l’Erythrée et le Mali avec chacun 89%, la Sierra Leone et le Soudan avec 88%.
Selon l’UNICEF, les MGF ont baissé de manière épatante au Kenya et en République de Centrafrique. La Centrafrique a fait la surprise de tous, par son action très discrète pour enrayer les MGF, en passant d’un taux de 43% dans le milieu des années 1990 à 24% en 2010. On ne peut pas en dire autant pour le Sénégal. Aucune baisse n’y a été notée depuis l’enquête de 2005, malgré les campagnes de sensibilisation menées par Tostan, un groupe de défense des droits humains. Molly Melching, directrice exécutive de Tostan a déclaré que l’élan a été accéléré au Sénégal depuis les 5 dernières années et que des changements pourraient être visibles à partir de 2020.
Dans plusieurs pays, ce sont les exciseuses traditionnelles qui pratiquent les mutilations. L’Egypte se démarque de ce lot par une prise conscience, qui en sauvera bien des vies. Conscientes que les instruments inadéquats des exciseuses pouvaient les conduire tout droit vers la tombe, 3 jeunes filles et femmes sur 4 se font couper les parties génitales par des professionnels du corps médical.
Dans tous les pays, une femme ou fille sur 5 sur qui sont faites les mutilations génitales subissent la forme la plus sévère, à savoir l’infibulation. Cette pratique consiste en l’incision de la bordure des grandes lèvres sur presque toute leur longueur, puis leur suture l’une à l’autre, couvrant le méat urinaire et l’entrée du vagin. Elle ne laisse qu’un minime pertuis très postérieur (à l’arrière) pour le passage de l’urine et des règles. La suture, la cicatrisation de l’agrafage de ce qui reste de l’ablation partielle des deux grandes lèvres, devra être séparée (désinfibulation) au moment du mariage. Bien d’autres coupures génitales sont faites, comme l’amputation de certaines ou de toutes les parties génitales externes. Tout ceci contribue à diminuer le plaisir sexuel des femmes et le risque qu’elles et leur bébé perdent la vie lors de l’accouchement.
L’enquête de l’UNICEF montre que plus d’hommes que de femmes notamment en Guinée, en Sierra Leone et au Tchad sont favorables à l’abolissement de ces mutilations génitales, considérées pour certains comme une coutume. Plusieurs femmes ignorent ce que pensent les hommes de ces pratiques, et sous-estiment le nombre de ceux qui voudraient qu’un terme y soit mis.
La principale raison pour laquelle les femmes refusent l’abolition des MGF est l’acceptation sociale. Selon l’enquête de l’UNICEF, plusieurs mères qui s’opposaient aux mutilations ont vu leurs filles les subir, juste pour ne pas être perçues comme des rebelles. « Cela montre le fossé entre l’état d’esprit et le comportement », a déclaré madame Cappa, of UNICEF. Elle ajoute qu’« une pensée individuelle n’est pas suffisante pour mettre un terme à cette pratique à cause des pressions et obligations sociales ».