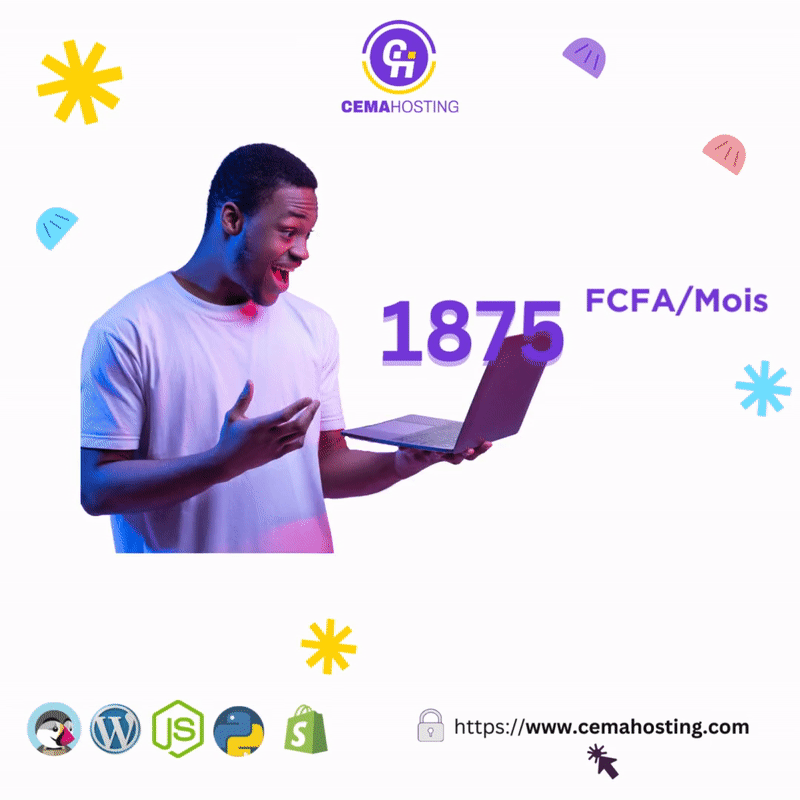Toliara (© 2025 The Conversation)- Le projet minier Base Toliara (ex-Tulear) dans le sud-ouest de Madagascar, ré-autorisé fin novembre 2024 par le gouvernement, après une suspension en 2019, ravive des débats passionnés sur l’exploitation des ressources naturelles à Madagascar.
Ce projet porté par l’entreprise américaine Energy Fuels suscite une forte opposition chez les populations locales en raison de ses impacts environnementaux, notamment la destruction d’écosystèmes et la pollution des eaux. Il exploite du sable minéralisé contenant de l’ilménite et les minéralisations de zircon et de rutile.
Le projet menace les moyens de subsistance des communautés locales. Ces dernières dénoncent également une répartition inéquitable des bénéfices, les profits étant largement captés par des acteurs étrangers (pour Base Toliara détenue par Energy fuels Inc basée aux Etats-Unis) au détriment du développement local. La méfiance est accentuée par des précédents miniers à Madagascar où les promesses économiques n’ont pas été tenues, alimentant des tensions sociales et des manifestations.
Entre promesses de croissance économique et craintes environnementales et sociales, les populations locales se retrouvent une fois de plus au cœur d’un dilemme complexe.
Nous sommes doctorants en économie à l’Université d’Antananarivo. Nos recherches portent sur la négociation collective dans les grandes entreprises à Madagascar et l’impact des dynamiques démographiques et de la qualité institutionnelle sur la croissance économique et la pauvreté.
Dans les lignes qui suivent, nous analysons les impacts économiques, sociaux et environnementaux du projet minier de Base Toliara à Madagascar. Selon nous, une transformation du modèle extractiviste en une véritable stratégie de valorisation locale des ressources est nécessaire, afin de garantir un développement durable et une meilleure répartition des bénéfices.
La “malédiction des ressources”
L’histoire regorge d’exemples où l’abondance de ressources naturelles a paradoxalement freiné le développement des pays, un phénomène connu sous le nom de “malédiction des ressources”. À Madagascar, les précédents miniers, comme celui de l’ilménite à Fort-Dauphin (Sud de Madagascar) avec l’entreprise QMM – Rio Tinto a généré 900 emplois directs, mais seulement 10 % des bénéfices ont été réinvestis localement entre 2010 et 2020. L’exploitation à QMM a été marquée par de multiples incidents environnementaux, notamment deux ruptures de barrages de résidus en 2022, entraînant une pollution massive de l’eau et la mort de nombreux poissons.
Ces événements, combinés à des problèmes d’indemnisation des populations locales, ont engendré de fortes tensions sociales culminant en de violentes manifestations en octobre 2023, et causant la mort de trois manifestants. Contrairement au Botswana, où les revenus des diamants financent des projets sociaux, les précédents malgaches montrent que les profits miniers bénéficient rarement aux régions productrices. La majeure partie est captée au niveau national.
Les craintes des populations de Toliara sont donc loin d’être infondées. Cela explique les manifestations du 17 février 2025 qui ont réuni plusieurs dizaines d’opposants en particulier de la communauté de pécheurs Zanadriake. Le rejet des dons de la compagnie Base Toliara par les pêcheurs d’Andranogadra (quartier de Toliara) illustre cette méfiance enracinée.
Pour eux, ces gestes perçus comme des tentatives d’achat du consentement ne sauraient compenser les menaces pesant sur leur mode de vie. « Nous ne voulons pas de la Base Toliara ici, et encore moins de ses dons », a clamé un représentant de l’association de pêcheurs Zanadriake. Il a souligné l’attachement des communautés à leur autonomie, à la préservation de leurs ressources marines voire même leurs manières de vivre. Ce refus catégorique traduit chez eux un sentiment d’injustice et une opposition farouche à un projet qu’ils considèrent comme une menace existentielle pour leur avenir.
Le projet Base Toliara, axé sur l’extraction de minéraux lourds, suscite des inquiétudes légitimes concernant la destruction d’écosystèmes fragiles. La pollution des eaux et des sols, ainsi que la perte de biodiversité, sont autant de risques qui pèsent sur la région.
Les communautés locales, dont la subsistance dépend souvent de l’agriculture et de la pêche, craignent de voir leurs moyens de subsistance anéantis. Les agriculteurs s’inquiètent de la contamination de leurs terres et de la raréfaction de l’eau. Les pêcheurs redoutent la destruction des récifs coralliens et la diminution des ressources halieutiques.
Une gouvernance à renforcer
La réussite d’un projet minier dépend en grande partie de la qualité de la gouvernance et de la transparence des processus décisionnels. À Madagascar, les lacunes en matière de gouvernance sont souvent pointées du doigt, avec des risques de corruption et de manque de redevabilité. Les derniers rapports de Transparency International vont dans ce sens.
Les populations locales veulent être impliquées dans les décisions qui les concernent. Elles réclament une gouvernance participative, où leurs voix sont entendues et leurs préoccupations prises en compte.
Dans cette optique, en février 2025, la direction de Base Toliara a cherché à instaurer un dialogue en partenariat avec la Commission justice et paix de Madagascar. Cette initiative vise à assurer que les droits des communautés locales soient respectés et que le projet bénéficie réellement à la population. Ce cas de « médiation » mérite attention.
Cependant, des doutes subsistent quant à l’impact réel de cette démarche. Malgré les déclarations d’intention de transparence et d’équité de l’entreprise, la méfiance demeure. Elle est alimentée par des précédents où les promesses de retombées économiques n’ont pas été tenues comme nous l’avons vu dans le cas de QMM-Rio Tinto.
De plus, les critiques soulignent que ce type de médiation institutionnelle ne remplace pas une véritable consultation démocratique et une prise en compte effective des revendications des communautés. La nouvelle réglementation sur l’évaluation environnementale et sociale vise à aligner les investissements sur les exigences environnementales.
Elle stipule que les autorités traditionnelles doivent collaborer avec le promoteur et les autres parties prenantes pour informer, consulter et concerter les communautés locales à chaque étape des processus d’évaluation et de suivi environnementaux et sociaux du projet.
Publié en janvier 2025, ce décret ne semble pas appliqué dans le cas de Base Toliara. Cette initiative dé médiation pilotée par l’Église catholique peut constituer un pas vers une meilleure gouvernance du projet. Elle devra toutefois se traduire par des actions concrètes et un véritable engagement à respecter les intérêts des populations locales, sous peine de voir la contestation perdurer.
Création de valeur
Le projet Base Toliara illustre les contradictions d’un modèle de développement encore largement fondé sur l’extractivisme, où l’exploitation des ressources naturelles au profit du Nord prime sur la transformation et la valorisation locale dans le Sud. Or, cette approche ne permet pas de garantir une autonomie économique durable.
À l’instar de réflexions portées par un certain nombre d’économistes, Madagascar doit repenser son rapport aux ressources naturelles. Il ne s’agit plus seulement d’extraire, mais de créer de la valeur sur place. Cette approche est d’autant plus cruciale que la transition vers une économie bas carbone nécessite un déploiement massif de technologies vertes, telles que les éoliennes, les panneaux solaires et les véhicules électriques.
Ces technologies, massivement déployées dans le Nord, sont gourmandes en minerais stratégiques (lithium, cobalt, terres rares, etc.), dont les réserves sont souvent concentrées dans quelques pays du Sud.
Une première étape consiste à cartographier stratégiquement les ressources pour identifier les potentiels d’exploitation. Ensuite, il est essentiel de déterminer comment les intégrer dans des chaînes de valeur locales et internationales. L’extraction brute, suivie d’une exportation sans transformation, doit céder la place à une politique industrielle capable d’ancrer les richesses minières dans l’économie nationale.
Cela implique la fin de l’économie extractiviste pure. Plutôt que de se limiter à la vente de matières premières, Madagascar pourrait investir dans le développement d’infrastructures industrielles pour le raffinage et la transformation des minerais. Cela permettrait de capter une plus grande part de la valeur ajoutée et de réduire la dépendance aux fluctuations des prix mondiaux des matières premières.
L’industrialisation du secteur minier doit également s’appuyer sur la formation et le développement de viviers de compétences. Sans ingénieurs, techniciens et ouvriers qualifiés, toute tentative de transformation locale restera limitée. Le développement de filières éducatives spécialisées et la coopération avec des universités et centres de recherche locaux doivent devenir des priorités stratégiques.
Enfin, pour assurer un réel bénéfice national, Madagascar doit encourager l’émergence de champions nationaux capables de structurer l’industrie minière au-delà de la simple extraction.
En soutenant des entreprises locales, en leur donnant accès aux financements et en leur permettant de participer activement aux projets d’envergure, le pays pourrait se positionner comme un acteur économique autonome et non plus comme un simple fournisseur de ressources pour les puissances étrangères.
L’enjeu n’est donc pas seulement d’exploiter les richesses du sous-sol, mais bien de transformer l’extraction minière en levier de développement. Sans cette réflexion stratégique, Madagascar risque de rester prisonnier d’un modèle économique qui, jusqu’ici, n’a pas tenu ses promesses pour la majorité de sa population.
The Conversation