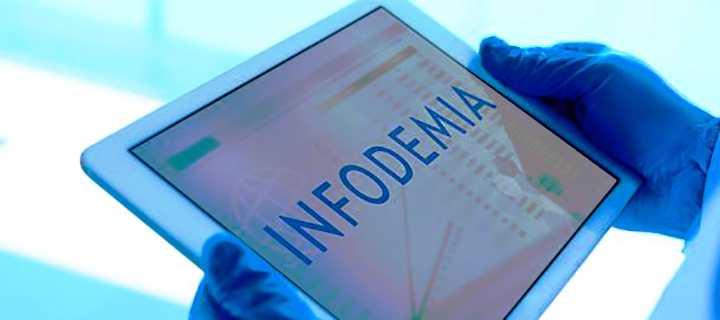Abidjan (© 2024 Afriquinfos)- La désinformation et la mésinformation, symptômes de cette maladie (infodémie) qui ronge nos corps sociaux et politiques constituent un défi premier pour tous les décisionnaires et les institutions publiques contemporaines.
Si ses motivations, leviers techniques et champs d’actions sont désormais bien connus et documentés, l’efficacité relative des différents types d’interventions visant à lutter contre reste mal évaluée, conduisant les pouvoirs publics à opter pour des méthodes inefficaces voire contre-productives. D’autant que, souvent cantonnées à des réactions ou des réponses à contre-temps aux éruptions de l’infodémie, qu’elles soient spontanées ou motivées, les stratégies adoptées ne les endiguent que très partiellement.

Rien de surprenant, quand on pense que dès le 16ème siècle, le philosophe Francis Bacon avertissait: «Calomniez ! Calomniez ! Il en restera toujours quelque chose». Dès lors, quelle option reste-il aux pouvoirs publics ? Une réponse semble désormais évidente et urgente: face à l’affect, faire le pari de la construction du savoir individuel et collectif.
Manipulation, propagande, rumeurs, apparition d’experts auto-proclamés sous effet Dunning-Kruger (liste non exhaustive) sont devenus un bruit de fond permanent, en particulier au temps actuel de crise aiguë: lorsque l’affrontement classique d’un ancien monde qui ne veut pas mourir face à un ordre nouveau tardant à émerger s’agrège en un effondrement progressif de notre environnement physique et moral global.
Si les sociétés ont intégré depuis longtemps que selon la formule de Rudyard Kipling, «la première victime de la guerre, c’est la vérité», et que les médias traditionnels de masse présentent des biais d’opinion inévitables, rien ne les avait préparés à absorber le choc de cette «tempête parfaite» informationnelle sur les affaires courantes, jusqu’aux fondements scientifiques les plus consensuels.
Or, outre les menaces intrinsèques posées par les crises elles-mêmes, l’infodémie renforce leur ampleur et participe à la création de nouvelles en complexifiant la tâche des institutions publiques dans leur prise de décision et leur capacité à faire adhérer la population cible à la légitimité du comportement social recherché ou de la réponse publique apportée.
La croyance en la désinformation COVID-19 a pu par exemple décourager les comportements de protection, y compris la vaccination, avec des conséquences potentiellement mortelles. L’exposition à la désinformation sur le changement climatique de son côté diminue les comportements pro-sociaux et l’acceptation des faits scientifiques.
Raison fondamentale de leurs succès: les fausses nouvelles sont faciles à créer et voyagent vite, 6 fois plus vite que les vraies sur X, d’après une étude américaine du MIT. Mais comment survivent-elles à l’épreuve des faits? Pourquoi la mauvaise information, à l’instar de la mauvaise monnaie, semble-t-elle chasser la bonne?
Une hypothèse plausible réside dans la «loi de Brandolini», énoncé non scientifique mais très empirique pour toute personne l’ayant vécu: l’énergie nécessaire pour réfuter un faux énoncé est de loin supérieure à celle qu’il a fallu pour le produire. Ce à quoi s’ajoute qu’au-delà de la démonstration parfois absurde qu’il faut déployer (comment démontrer l’inexistence de quelque chose qui n’existe pas ?), cela requiert un trésor de patience qui n’est pas à la portée de tout être humain.
S’outiller contre l’infodémie, un chantier
A l’échelle d’une institution publique, cela revient à mener des opérations de démentis et de debunkage partiellement inefficaces au regard de leurs coûts comparés aux effets obtenus. Pire, la source du message est placée sous le sceau de la suspicion, et par conséquent peut renforcer la cible dans sa conviction erronée, au prétexte que l’existence même de la réaction valide le bien-fondé de l’information fausse initiale.
De plus, les acteurs publics responsables doivent veiller à ce que le droit à la liberté d’expression ne soit pas violé par des dispositions trop larges qui criminaliseraient ou simplement paralyseraient l’expression publique, même la plus saugrenue. Il en va là du respect du contrat social qui nous lie, et de la prudence nécessaire vis-à-vis d’un arsenal répressif qui, au prétexte de lutter contre un type de discours, risquerait de pénaliser, au sens premier, l’ensemble des expressions des oppositions.
Enfin, que peut faire une explication rationnelle a posteriori face aux marchands de formules creuses mais racoleuses, ou à ceux dont le raisonnement s’apparente à des bouffées délirantes ? Plus structurellement, comment répondre aux angoisses des déshérités qui cherchent à comprendre chaque obscur retournement du monde, et à qui n’appartenait pas ce qui était, et pas encore ce qui s’approche ?
C’est donc en amont que ce combat doit être mené. C’est en travaillant à la construction de la légitimité, de la crédibilité et de la confiance entre les décideurs, les institutions et les citoyens que ce phénomène redeviendra ce qu’il a été pendant longtemps: un effet marginal et collatéral du débat public. Dès lors, plusieurs pistes doivent être envisagées.
En matière d’éducation civique, approfondir les connaissances des nouvelles générations sur la création, l’analyse, le traitement et le recoupement de l’information, ou encore le fonctionnement et l’organisation des médias ainsi que de la publicité. Renforcer également les exigences d’exemplarité des décideurs et les sanctions vis-à-vis des abus de position afin de lutter contre les sentiments d’exclusion et d’existence d’une justice de caste qui alimentent les théories du complot, et défont insidieusement les liens sociaux. Surtout enfin, dépasser l’approche normative ou descriptive de l’action publique pour revenir à la source de sa légitimité: le principe de publicité des décisions, exercice de transparence et de pédagogie comme socle de toute communication institutionnelle média et hors-média.
Il faut sortir le pouvoir du bois sacré car son apparence mystérieuse, source d’autorité autrefois est devenu un boulet. Soyons réalistes, regagner la bataille de la raison sur l’émotion, celle du doute légitime sur la suspicion systématique prendra du temps. Autant commencer à adopter les bonnes mesures dès à présent.
Afriquinfos