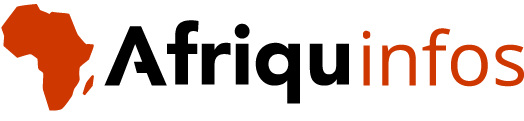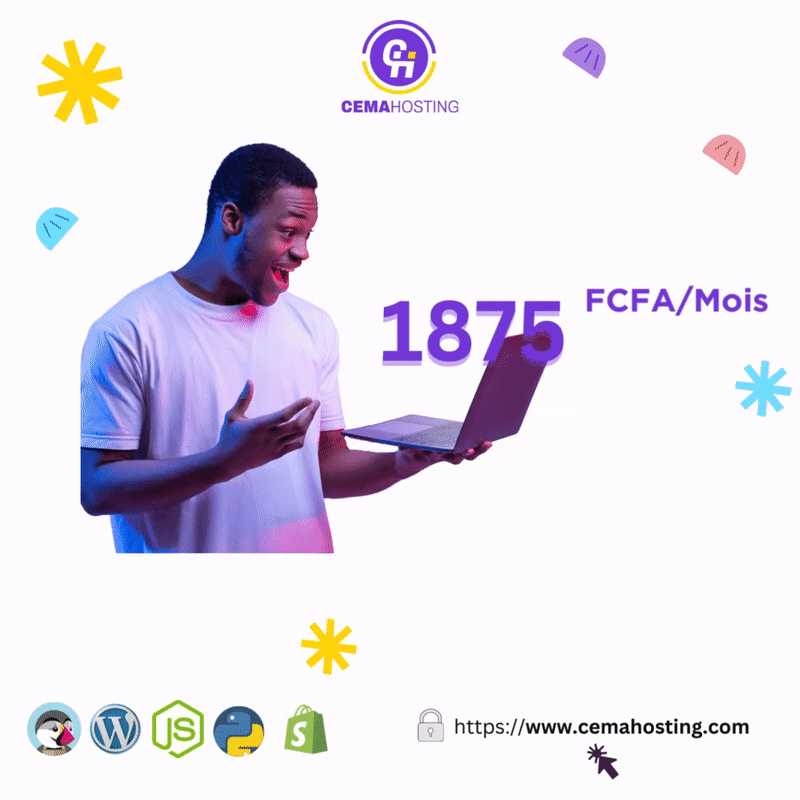Mon chauffeur, Bien-Aimé (c'est son prénom), coupa le moteur de la robuste Toyota Land Cruiser blanche, repérable à mille lieux grâce à son imposante antenne et lança à mon endroit d'un ton triomphal : « Nous y sommes ! » Le cadran horaire du tableau de bord affichait 11H58. Courtois et avare en paroles, comme le sont souvent les natifs des Hautes-Terres malgaches avec les étrangers, cette annonce mit un terme à un silence religieux de près de trois heures. Nous étions partis quelques heures plus tôt de Ranomafana, situé à 410 km de Tana où nous avions pris un bain bienfaiteur aux thermes chaudes et soufrées et passé une nuit réparatrice au "Grenat", un gîte d'étape de huit bungalows venant juste d'ouvrir ses portes.
Sur la route nationale (RN12), étroite et sinueuse, Bien-Aimé, en chauffeur aguerri, et Louisette, en chef de projet parfaitement consciente des dangers de ces virages interminables qui, à la moindre inattention, pouvaient nous être fatals, avaient préféré garder les yeux rivés sur la chaussée.
Découvrant la côte sud-est de Madagascar pour la première fois depuis mon arrivée dans la grande île, j’ai préféré savourer sans retenue les délices du paysage qui défilait devant mes yeux. Les crêtes verdoyantes des massifs montagneux couronnés de jacquiers aux fruits surdimensionnés, de bananiers, de litchis et d'arbres du voyageur, ces géants aux feuillages dentelés, étaient un émerveillement pour les sens.
Au bout de l'allée rectiligne et proprette bordée de palmiers devant laquelle le véhicule s’immobilisa, se profilaient trois bâtisses à la peinture défraîchie. L'air y était frais et vivifiant. Une atmosphère printanière régnait en ces lieux. Pourtant, nous sommes en plein hiver austral. Au début de l'allée couverte de sables fins se dressait un écriteau sur lequel on pouvait lire, en rouge, noir et or, l’inscription suivante : Centre d'Accueil et de Transit des Jumeaux Abandonnés, en abrégé CATJA. Sur le coin supérieur gauche du panneau de signalisation, un soleil ocre brillait de mille éclats. Au centre du disque solaire, une grande main tendue vers une autre nettement plus petite.
N'eut été le dernier qualificatif "abandonnés", on aurait pu prendre cet endroit pour un centre de loisirs ou un lieu de villégiature pour « Vazaha », « étrangers », en langue malgache.
Je m'empressai d'enfiler un pantalon blue jeans. Depuis notre départ de Ranofamana, j'avais en effet gardé sur moi une blouse en lépi – cotonnade en indigo produite dans le Fouta – reçue en guise de cadeau en Guinée -, un short cycliste un peu trop près du corps et plus digne d'une salle d'aérobic que d'un centre pour enfants abandonnés, des pantoufles bleues, souvenirs d’un récent passage à Pretoria.
Ce détour par Mananjary, commune rurale de 100 000 âmes située à 600 kilomètres de la capitale, Tananarive, n'était pas inscrit au programme concocté par Louisette, d'où sa nervosité et, sans doute aussi, son mutisme. Elle devait se soucier de la distance qu'il nous faudrait désormais parcourir pour arriver à Farafangana, bourgade située 230 km plus au nord de Mananjary avant la tombée de la nuit, avec tous ces voleurs de zébus qui écument les routes et dépouillent les voyageurs, l'arme à la main.
Cet accroc au programme me semblait indispensable. Une dizaine de jours auparavant, une dame dont j'ignorais jusqu’à l'existence avait, sous le prétexte de vouloir me vendre des publications de son institut, demandé à me rencontrer. J'avais accepté de la recevoir sans grande conviction. Une rapide consultation du moteur de recherche Google me révéla que Gracy Fernandez – c’est son nom – était une sociologue confirmée. C’est elle qui m’a tout appris du sort tragique réservé aux jumeaux de Mananjary.
Au fur et mesure que nous avancions dans l'allée, des cris d'enfants se firent entendre. Une femme entre deux âges, surprise de notre intrusion, apparut sur le seuil du premier bâtiment. Elle réajusta sa tenue et d'un pas mesuré avança vers nous. Elle portait une jupe et d'une blouse en noir et blanc. Son sourire était avenant et sa voix infiniment douce.
Louisette fit les présentations en malgache et la jeune dame, qui était vraisemblablement la maîtresse des lieux nous invita, dans un français parfait, à la suivre et nous installa dans son salon, un univers sobre et bien tenu. Je m'excusai de cette visite inopinée, de surcroît un dimanche. Je lui expliquai qu'en mission dans la région, j'avais décidé de passer à Mananjary pour visiter le centre des enfants abandonnés. Je lui parlai de la rencontre avec Madame Fernandez mais surtout d'un événement que mes compagnons de voyage ignoraient : deux jours avant notre départ de la capitale, une amie originaire de la Côte d'Ivoire et beaucoup plus jeune que moi, avait adopté deux jumelles de ce centre.
Julie, c'est le prénom de la dame qui nous accueillit, me confirma que les fillettes Liva et Lova étaient bien parties du centre pour Tana. Elles y avaient été abandonnées dès leur naissance par leur mère. Julie m'avoua qu'en me voyant sortir de la voiture, elle avait cru un instant qu'il s'agissait de mon amie qui venait d'adopter les jumelles. J'en ai déduit qu'il devait y avoir peu de femmes africaines originaires du bloc continental que l'aventure poussait jusqu'aux portes de ce centre d'accueil.
S'ensuivit une discussion à bâtons rompus sur les activités du centre et sur le destin funeste des jumeaux de Mananjary.
La légende raconte qu'il y a longtemps, très longtemps, vivaient le long du canal des Pangalanes, un cours d'eau navigable toute l'année et qui traverse sur 700 kilomètres plusieurs régions du sud-est de la Grande Ile, les Antambahoakas, une tribu guerrière, noble et courageuse. Un jour, vinrent les hordes ennemies, nombreuses comme des chauves-souris. Il a fallu tout abandonner, trouver refuge dans les grottes et les forêts avoisinantes. Lorsque les fuyards arrivèrent dans leur cachette, le chef de tribu se rendit compte que l'un de ses jumeaux manquait à l'appel. Dans leur fuite précipitée, les Antambahoakas avaient oublié un des fils du chef au village. N’entendant que son courage, ce dernier décida d'aller le chercher. Conscients de l'amour qu'il portait à son fils, l'ennemi attendit patiemment le retour du chef et le massacra.
Fou de rage et de tristesse, le peuple antambahoaka tint les jumeaux pour responsables de la mort de leur chef et décida que plus jamais naissance gémellaire ne produirait de descendance à Mananjary.
L'histoire n'ayant pas retenu le sexe des jumeaux, consigne fut donnée que ni jumeaux, ni jumelles ne devaient plus vivre dans la communauté. Les Antaimoros, une autre ethnie voisine, décidèrent, pour ce qui les concerne, de ne garder qu'un des jumeaux. Le second étant soit tué, soit abandonné dans des conditions où la mort apparaissait comme une délivrance.
C'est ainsi qu'une tradition, née certainement de l'imaginaire (puisque l'origine se perd à travers les différents récits) et nourrie par la cruauté et l'ignorance des hommes, scella à jamais le sort des jumeaux de Mananjary, condamnés au terrible châtiment de devoir mourir de froid et de faim le long du canal des Pangalanes.
En contemplant les eaux limpides et nonchalantes, source de vie pour des milliers de pêcheurs et de marchands, on a du mal à appréhender le nombre incalculable de corps frêles retrouvés sans vie dans le fleuve et enterrés subrepticement avec la complicité de toute une communauté.
Le centre de Mananjary est né en 1987 de la volonté d'un évangéliste, qui a fait fi des croyances, ayant lui-même été orphelin avant d'être recueilli par un médecin. Cet évangéliste reçoit depuis vingt-quatre ans les jumeaux frappés par la malédiction, mais également des enfants souffrant d'handicaps moteurs et cérébraux ou tout simplement des orphelins abandonnés qui par un père, qui par une grand-mère sans ressource.
C'est ainsi que CATJA est devenu le centre de l'adoption le plus populaire de Madagascar et le lieu de transit par excellence des jumeaux et enfants abandonnés du sud-est. Les plus chanceux des pensionnaires, généralement âgés de moins de deux ans, sont accueillis dans des familles d'adoption, en France. Pour les autres, notamment les enfants handicapés, le transit peut durer toute une vie.
En dépit de l'histoire tragique derrière chacun de ces visages angéliques, il règne dans ce centre une certaine joie de vivre. Les vingt-sept employés volontaires au service des jumeaux et enfants abandonnés n'ont pas le temps de dénoncer ces pratiques d'un autre âge. Il faut faire face, chaque jour, aux corvées d'eau, de préparation des repas, de lavage et repassage des tonnes de vêtements, de changement de couches, de chauffage des dizaines de biberons, des travaux du potager, de l'attelage des sept zébus pour les labours.
Entre deux corvées on pouponne, on câline, on soigne, on essaie de réconforter. Julie l'héritière et veuve de l'évangéliste, décédé en 2004, doit trouver une tonne et demi de riz tous les mois pour nourrir les enfants et le personnel, sans subventions de l’Etat. Elle est mère de cinq enfants, dont deux en bas âge, élevés dans les mêmes conditions que ses pensionnaires.
Elle nous fait visiter les différents aménagements. L'étable où sept zébus grassouillets ruminent tranquillement l'herbe fraîchement cueillie des champs et des rizières, le château d'eau, la salle qui fait office de réfectoire, de salle de télé et salle d'étude pour les enfants âgés de cinq à dix huit ans, les dortoirs où dorment côte à côte des dizaines de jumeaux et jumelles dont les plus jeunes ont tout juste trois mois. Au total Quatre-vingt-douze enfants vivent en permanence dans le centre. Le premier bâtiment, construit depuis vingt ans, tombe en ruines et sera bientôt restauré.
Avec le durcissement de la loi sur les adoptions l'abandon des jumeaux s'est accentué. Les parents biologiques, découragés par les nombreux déplacements à leurs frais que suscitent les nouvelles procédures d'adoption, ne les amènent plus au centre. Ils préfèrent les laisser mourir le long des berges du canal.
Par ailleurs, parmi les petits êtres frêles et chétifs dormant dans les berceaux, figurent aussi les orphelins abandonnés par la famille. Le simple fait que leur mère soit décédée en couche les classe parmi les enfants « porteurs de malheur ». Un autre « fady » ou tabou.
Le temps passe vite nous devons repartir. Les baguettes de pain et les barres de chocolat achetées la veille à la station Galana pour les femmes de Farafangana sont distribuées aux enfants. Bien-Aimé, toujours silencieux, a les yeux embués de larmes. Il avouera en cours de route qu'il était au courant de cette tradition mais ne pouvait guère imaginer que la folie des hommes pouvait conduire à une telle barbarie.
En sortant du centre, après avoir parcouru en sens inverse les trois kilomètres de piste qui séparent CATJA de la route principale, la vie continue. Le ciel est dégagé. Entre la bande de terre qui sépare le canal des Pangalanes de la mer, un groupe d'hommes parie sur un combat de coqs. Nous sommes au 21e siècle et la malédiction des jumeaux de Mananjary n'est pas une légende. Pour preuve, tous ces clichés tirés à la va vite avec mon smartphone Blackberry. Ils représentent celles et ceux qui ont eu la chance d’échapper au terrible châtiment infligé aux jumeaux. A leur naissance, un ange bienveillant s'était penché sur leur berceau fait de roseaux et de feuilles de nénuphars…
Afriquinfos